CHAPITRE I :
« Au feu, au feu ! Réveillez-vous vite, tout est embrasé ! »
Ce hurlement sinistre, déchirant la nuit paisible, fit brusquement sursauter Étienne.
Tout somnolent, il se redressa péniblement sur sa paillasse. Assis, l’esprit encore embué par le sommeil, il avait du mal à émerger. Il était à la limite entre le songe et la réalité, cet instant flou et désagréable où on ne sait toujours pas si on est réveillé ou si on continue à rêver. Morphée semblait vouloir l’étreindre de nouveau dans ses bras alors que sa conscience ou son instinct lui dictait de se lever.
C’est le piétinement et les cris dans le vieil escalier en bois, menant dans la chambrée où il dormait avec tous les autres journaliers, qui l’extirpèrent définitivement de sa léthargie. La porte du dortoir s’ouvrit violemment et l’air affolé, encore en chemise de nuit, Juliette apparut et brailla : « Vite, sortez ! La maison brûle ! Tout brûle ! » La cuisinière de la ferme avait à peine achevé sa phrase que tous les ouvriers agricoles étaient déjà en train de dévaler l’escalier branlant.
Seul Étienne Lecomte ne bougea pas. Il se contentait d’observer avec curiosité Juliette qui se tenait pétrifiée sur le seuil de la porte. Depuis qu’il avait été engagé comme valet charretier dans cette exploitation, la ravissante cuisinière avait toujours été son rayon de soleil. Il l’avait tout de suite trouvée très belle, comme tous les autres hommes de la ferme d’ailleurs. Lorsque le midi, elle venait apporter la soupe aux manouvriers éreintés par leur labeur, elle faisait oublier un instant les fatigues du corps. Tous, en vidant goulûment leur écuelle, la regardaient aller et venir, sa jupe balayant l’air et la poussière, ses lèvres dessinant un sourire qui réchauffait les cœurs. Aucun ne la quittait des yeux. Rien que par sa présence, elle ranimait les ardeurs, redonnait des forces, ravivait la flamme de leur courage. Étienne pensait que dans ces moments-là, elle était un bel ange blond descendu du ciel pour soutenir ces forçats des champs.
Mais cette nuit, la peur et l’angoisse l’avaient littéralement métamorphosée. Sa longue chevelure dorée que sa coiffe contenait avec peine d’habitude s’était transformée en une masse de fils hirsutes. Ses cheveux blonds qui lui avaient toujours semblé doux comme de la soie étaient devenus du foin. Ses jolis yeux bleus, qui lançaient souvent des œillades et que chaque journalier qui se sentait visé prenait pour argent comptant, n’étaient plus que des billes roulant d’effroi, sortis de leur orbite. Sa douce voix cristalline avait fait place à un aboiement. Sa taille menue gracieusement drapée habituellement dans une jupe de lin n’était plus que grossièrement enveloppée dans une mauvaise chemise qui lui sembla être un sac de toile. Son fin visage immaculé avec deux jolies pommettes légèrement rosées semblait une figure boursouflée et écarlate. Il ne comprenait pas comment un être aussi charmant avait pu muter en une telle créature. Cette fois il en était sûr, il ne rêvait plus mais il ne lui semblait pas concevable non plus qu’il soit dans la réalité, il pensait cauchemarder. C’est un coup dans l’épaule qui le tira de ses réflexions. Il regarda cette sorcière le traîner presque vers la sortie et qui criait : « Mais sors donc, idiot, ou tu vas finir comme un jambon dans son fumoir. Bouge-toi. Tout va brûler. » Il se leva enfin au grand soulagement de la fille et la suivit en courant dans le petit escalier.
C’est en surgissant dans cette cour en effervescence qu’il réalisa soudain l’ampleur du désastre. C’était une scène horrible, digne de certains écrits apocalyptiques. Si le corps des logis dont il venait de sortir était encore épargné par l’incendie, par contre tous les bâtiments agricoles situés au Nord étaient déjà en proie aux flammes. La fournaise était telle qu’elle réchauffait la nuit glacée. Attisé par les rafales de vent, le feu redoublait de vigueur et se propageait avec une rapidité foudroyante aux communs. La petite charterie n’était déjà plus qu’un immense brasier incandescent. Et à chaque souffle, à chaque expiration, ce vent hostile soulevait des brandons qui virevoltaient, voltigeaient dans les airs avant de se poser sur le toit de chaume desséché de l’étable qui s’enflamma à son tour.
Étienne resta bouche bée devant ce spectacle, terrifiant et fascinant à la fois. Il voyait des flammes gigantesques et des nuées d’étincelles s’élever dans les ténèbres, illuminant les alentours, dans un vacarme infernal de crépitement et de craquement. Le pire était sans doute le cri des animaux condamnés dans l’étable en feu. La couverture en flammes s’effondrait sur les malheureuses bêtes sans que personne ne puisse les secourir. Les hennissements et les mugissements étaient méconnaissables. Sous la douleur, les bêtes hurlaient véritablement. Étienne croyait être devant la porte de l’enfer dont parlaient parfois les prêtres durant leur sermon. Ces cris semblaient être les râles des damnés que torturaient Belzebuth et ses démons. Ces flammes qui crépitaient devaient sans doute jaillir des entrailles de la terre où souffraient les pécheurs. Il croyait avoir la Géhenne en face de lui.
Égaré dans ses pensées, il ne prêta aucune attention au personnel de l’exploitation courant inutilement en tout sens pendant que le régisseur en chemise de nuit et pieds nus se lamentait et pleurait devant le sinistre.
Le sauvetage peinait à s’organiser. Les femmes puisaient l’eau du puits et la reversaient, non sans en faire couler la moitié par terre, dans les seaux en bois que tendaient les hommes affolés. Ils ne cessaient de courir vers l’étable et jeter en vain le liquide pour éteindre le feu.
Deux autres avec des haches tentaient de briser la planche qui barrait la porte en flammes. Mais le feu leur chauffait dangereusement le visage et les bras. Dès qu’ils s’approchaient de trop, la chaleur devenait insoutenable, ils étaient obligés de battre en retraite. Ils entendaient impuissants le craquement des poutres calcinées qui tombaient sur les bêtes. Les cris se taisaient les uns après les autres.
Toutes succombaient.
La porte de l’étable s’ouvrit soudain dans un grand fracas d’où jaillit une torche vivante. Elle se mit à galoper désespérément à travers la cour, faisant fuir les sauveteurs sur son passage enflammé. Étienne eut quelques peines à reconnaître la jument avec laquelle il travaillait dans les champs. Sa robe gris-blanc était désormais couleur suie et du liquide suintait des affreuses cloques sanguinolentes qui couvraient son corps. Sa crinière et sa queue n’étaient plus que des flambeaux. A voir cette bête en feu, caracolant en tout sens, illuminant la cour, on aurait dit un de ses toros de fuego qu’on allume parfois sur les places d’Espagne à la nuit tombée, c’est ce qu’on aurait cru si des hennissements déchirants ne trahissaient son horrible supplice. Les flammes grillaient ses crins, rongeaient son cuir, pénétraient les chairs. Le cheval en feu se tordait de douleur, se roulait à terre, ruait, se dressait, bondissait comme s’il luttait contre des ennemis invisibles qui le harcelaient sans répit, qui le dévoraient. Et brusquement, il s’effondra de toute sa masse, terrassé par le feu.
L’animal gisait à terre. Quelques fumées s’échappaient encore de son corps brûlé. Tout le monde resta cloué sur place, muet d’effroi devant ce terrible spectacle tandis que le régisseur mordait son bonnet de nuit de rage.
C’est alors qu’un homme attrapa Étienne par le bras et tout en lui confiant une hache, il lui lança : « Viens nous donner un coup de main, le corps des logis risque aussi de brûler. Il faut stopper la progression du feu. » En effet, les langues de feu qui couraient sur l’étable commençaient à lécher le mur en pierre du bâtiment principal. Deux échelles furent jetées hâtivement sur la couverture du logis. Étienne grimpa à la suite de son compagnon sur l’une d’elles. Arrivés au sommet du bâtiment menacé, ils arrachèrent frénétiquement les ardoises à coups de hache. Lorsqu’un passage fut ouvert dans la couverture, les deux hommes s’engouffrèrent dans le sombre grenier et s’attaquèrent aux chevrons qui commençaient à brûler. Un troisième homme entra à son tour avec un levier et se mit aussi à l’ouvrage. Ils commençaient à être sérieusement incommodés par la fumée qui envahissait la pièce. Elle leur piquait les yeux, brûlait les bronches, les faisait pleurer et tousser. Malgré cette nouvelle épreuve, Étienne frappait avec sa hache de toutes ses forces sans réfléchir. Il cognait fiévreusement. Et il cognait de nouveau avec furie jusqu’à ce qu’un formidable coup de pied aux fesses vienne calmer ses ardeurs. Surpris, il se retourna et vit son coéquipier, dégoulinant de sueur dans cette fournaise, qui lui beuglait presque sous le nez : « Sacrédié, fais un peu attention, bougre de sot, ne coupe pas les poutres-maîtresses sinon tout va s’écrouler sur nous. Regarde-là, tu as entaillé le lien de faîtage, triple buse. Il faut seulement détruire une partie des chevrons pour que le feu ne trouve plus rien à se mettre sous la dent. » Secoué par ces remontrances, il se remit au travail sous l’œil colérique de son compagnon. Pendant ce temps, d’autres sauveteurs arrivèrent sous les combes et jetèrent autant d’eau qu’ils pouvaient sur le mur et les poutres principales pour éviter qu’ils s’enflamment.
Un énorme craquement se fit brusquement entendre, comme un ultime gémissement de douleur. Presque aussitôt le bâtiment dans lequel ils se trouvaient se mit à vibrer, toute la charpente trembla. Tous retinrent leur respiration, stoppèrent leurs gestes, se demandant ce qu’il se passait encore. Ils se voyaient déjà pris au piège dans cette vieille bâtisse, entourés par les flammes, encerclés par la fumée. Certains commençaient à paniquer, à hurler. Ils cherchaient à fuir car ils se figuraient que la couverture allait s’effondrer sur eux ou que le plancher allait s’ouvrir pour les précipiter dans un abîme de feu. L’imagination des hommes devant le danger n’a plus de retenue. Accompagnée par la peur, elle galope, fait perdre tout sens commun. L’instinct de conservation resurgit brutalement des tréfonds de chaque être, rend l’humain plus bestial, fait oublier toute sociabilité, efface les anciennes amitiés, néglige les fraternités. Chacun ne pense plus qu’à sa peau et repousse, bouscule, insulte, frappe tous ceux qui cherchent à échapper avant lui à cet édifice qu’il voit déjà comme son tombeau. A l’inverse des autres, Étienne et son compagnon ne bougeaient pas, ne soufflaient mot, ils étaient comme pétrifiés. Ils attendaient ce qu’ils croyaient être leur mort. Toutefois, plus rien ne remuait, plus rien ne craquait. Il y eut même quelques instants de silence angoissant, comme si Dieu, ou le Diable, pour mieux décider du sort de ces mortels, avait suspendu le cours du temps. C’est alors que le craquement se fit de nouveau entendre. C’était l’étable devenue un énorme brasier qui se pliait, chancelait sur elle-même avant de s’affaisser complètement dans un vacarme assourdissant. D’énormes volutes d’étincelles et de fumées noires s’élevèrent subitement vers le ciel, obligeant les sauveteurs à refluer en désordre pour ne pas être asphyxiés.
Mais malgré ce dernier sursaut, le feu était vaincu. Il consumait encore quelques planches, brûlait quelques carcasses mais faute de nouveaux combustibles, de nouvelles victimes à dévorer, il commençait à perdre de son intensité et ne menaçait plus le haut du corps des logis ainsi que ses occupants. Parmi les décombres de l’étable, le feu n’opposait plus qu’une faible résistance face aux hommes déchaînés. A coups de seaux d’eau, fiévreusement, frénétiquement comme pour exorciser leur peur, ils étaient en train de l’achever. Certains étouffaient les dernières flammes qui couraient encore sur le bois en les frappant avec des couvertures. On vit même un homme en larmes qui écrasait et piétinait rageusement avec ses sabots les derniers tisons. Il ne voulait laisser aucun répit à cet ennemi qui avait provoqué en lui la pire terreur de sa vie. Totalement choqué et sans cesser de sangloter, il semblait courir sur les braises comme un fou furieux pour anéantir les rares flammèches encore animées.
Puis un à un, alors que l’aube pointait à l’horizon, les sauveteurs, éreintés par ce combat nocturne, quittèrent le champ de bataille. Les nerfs à vif, le visage et les bras noircis, ils se laissèrent tomber contre le mur rugueux du corps des logis, miraculeusement indemne.
Le brasier n’étant plus là pour réchauffer ce glacial matin de novembre, ils se mirent à frissonner. Les jambes recroquevillées contre le ventre, les mains placées sous leurs aisselles pour profiter au maximum de leur propre chaleur, ils se laissèrent sombrer dans un sommeil nerveux. Épuisés, ils n’avaient même plus la force de faire le moindre geste. Ils ne voyaient même plus le régisseur qui calculait déjà les pertes de la nuit. Aucun d’entre eux ne s’occupait des deux chiens qui déchiraient avidement le flanc du cadavre calciné de la jument. Ils ne semblaient même pas incommodés par cette odeur âcre et nauséabonde qui flottait autour d’eux et qui en temps ordinaire leur aurait soulevé le cœur. Personne ne faisait attention non plus à cet homme qui errait toujours, hagard et gémissant, parmi les ruines fumantes de l’étable, seulement accompagné de sa folie naissante.

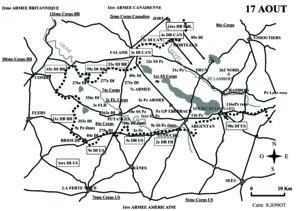



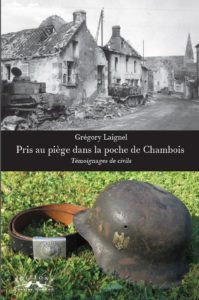



 Journal Ouest-France, le 28 mai 2015
Journal Ouest-France, le 28 mai 2015 Journal Ouest-France, le 13 décembre 2013
Journal Ouest-France, le 13 décembre 2013 Journal Ouest-France, le 28 janvier 2014
Journal Ouest-France, le 28 janvier 2014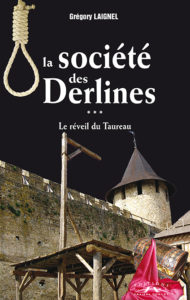
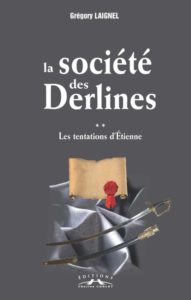

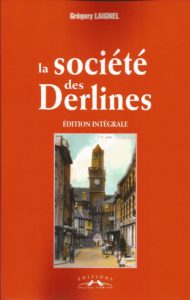 Novembre 1764. Etienne Leconte, jeune charretier sans emploi, erre le ventre vide au cœur du bocage virois. Après quatre longues années d’absence, lassé de tirer le diable par la queue, il s’en retourne à Fresnes, sa paroisse natale, retrouver sa mère et son frère. Quelle n’est pas sa surprise en arrivant dans son village : sa famille n’habite plus leur humble masure mais une solide longère ; sa mère, une brave femme énergique et volontaire, n’est plus que l’ombre d’elle-même, terrassée par une maladie inconnue ; quant à son frère, de simple paysan, il est devenu un marchand de draps fortuné, un homme important et redouté depuis qu’il est à la tête de la mystérieuse Société des Derlines…
Novembre 1764. Etienne Leconte, jeune charretier sans emploi, erre le ventre vide au cœur du bocage virois. Après quatre longues années d’absence, lassé de tirer le diable par la queue, il s’en retourne à Fresnes, sa paroisse natale, retrouver sa mère et son frère. Quelle n’est pas sa surprise en arrivant dans son village : sa famille n’habite plus leur humble masure mais une solide longère ; sa mère, une brave femme énergique et volontaire, n’est plus que l’ombre d’elle-même, terrassée par une maladie inconnue ; quant à son frère, de simple paysan, il est devenu un marchand de draps fortuné, un homme important et redouté depuis qu’il est à la tête de la mystérieuse Société des Derlines…